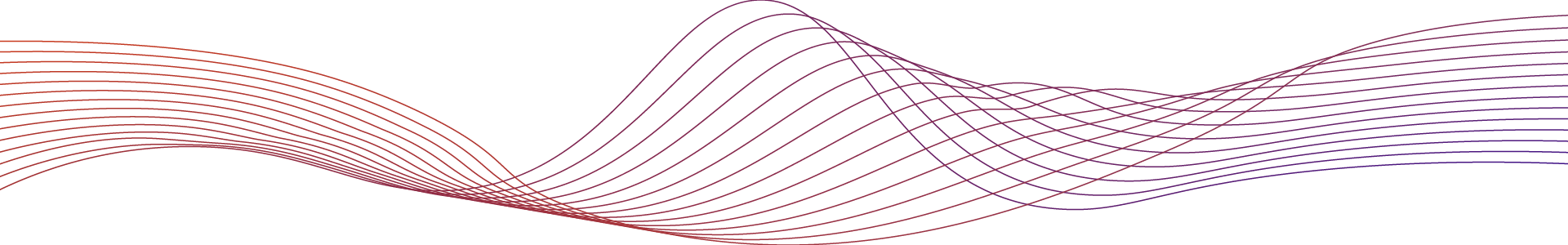
Alain Leobon
Présentation
CV D’ALAIN LEOBON
Nom d’usage : LEOBON Prénom : ALAIN
Section(s) du Comité national (d’examen de la candidature) : Section 39.
Affectation (code et intitulé de l’unité de recherche) : UMR 6590 ESO ESO Espaces et Sociétés du CNRS, ESO-Rennes - Université Rennes 2 Maison de la Recherche en Sciences Sociales Place du Recteur Henri Le Moal 35043 RENNES CEDEX
Évolution des thématiques dans ma carrière scientifique
Thématique A : Environnement sonore : objets, ambiances et paysages
La première partie de ma carrière m’a conduit à travailler sur les « aménités urbaines » lues au travers de leurs « paysages sonores ». Cette approche descriptive de l’environnement sonore urbain fut initiée dans le cadre de mes travaux de recherche avec Abraham MOLES entre 1980 et 1986, prolongée au Laboratoire de Mécanique physique de l’URA 879 du C.N.R.S. puis au CARTA (l’UMR N° 6590 – ESO), et enfin enseigné dans le cadre de la formation pluridisciplinaire du C.E.A.A - D.E.S.S. « Acoustique Architecturale et Urbaine » (Université Paris 6 - École d’Architecture Paris La Défense.
Mes travaux de recherches, associant des architectes, urbanistes et sociologues, m’ont conduit à développer des méthodes et d’outils permettant de décrire l’environnement sonore urbain, d’en caractériser les ambiances, puis de les cartographier [modèle « SACSSO [1] »]. Cette description du paysage sonore fut adossée à une approche micropsychologique de la perception sonore des usagers et des habitants des terrains explorés [modèle des « conduites d’écoutes »]. Alliant analyse structurale et l’approche phénoménologique, ces modèles furent appliqués au quartier Graslin, puis étendus à l’ensemble du cœur historique de la ville de Nantes [REF1], permettant d’objectiver l’impact sonore des aménagements urbains et celui de l’animation des zones piétonnes.
Mon intégration [en 1996] au CARTA [ESO – Angers], m’a conduit à enrichir l’approche cartographique des ambiances par l’addition de cartes de « bruyance » présentant les niveaux de bruit relevés sur les 150 points fixes d’enregistrement du cœur historique nantais. L’intégration dans un SIG de plusieurs couches d’informations a permis 1) de mettre en relation les cartes d’ambiances et celle de niveaux avec les plaintes et « mains courantes » identifiées auprès de la police nationale, des services locaux et préfectoraux de la ville de Nantes, puis 2) de créer un modèle prévisionnel des espaces potentiellement « sensibles » amenant à des recommandations de solutions techniques pour certains établissements recevant du public autour desquels se construisaient des conflits entre résidents et clientèles (ex. : le bar « Le Plein Sud » ou le bar « Le Petit Marais »). D’autres mesures ont permis de caractériser et de cartographier les changements opérés (en termes d’ambiance et de niveau) par l’opération « en ville sans ma voiture » (http://paysage-sonore.net).
L’impact scientifique de ces travaux fut : 1) d’avoir orienté l’approche environnementale des phénomènes sonores des villes vers des notions plus qualitatives où les paramètres acoustiques n’était plus les seuls éléments pris en compte 2) de produire des outils permettant d’atteindre une connaissance très fine des ambiances dans les secteurs urbains centraux et animés dont les caractéristiques urbanistiques, architecturales ne sont pas ignorées, 3) de replacer la population ou plutôt l’individu dans ses pratiques quotidiennes de l’espace pour 4) comprendre les situations de conflits d’usage de l’espace public (où le bruit, désigné comme le fondement de la gêne, n’est souvent qu’un bouc émissaire). Le rayonnement scientifique fut conséquent sur le plan local et national et grand public, ce travail ayant été valorisé par CNRS Info et par le Journal du CNRS, dans nombre de médias locaux (Ouest-Fance, Presse Océan), nationaux (Le moniteur des villes, revue Décision environnement, Le courrier des Maires) ou internationaux (« The New Scientist »), l’obtention, en 1993, du « Le Décibel D’or » par la Ville de Nantes ayant conduit à plusieurs interviews (radio et télévisés) et à des vidéoreportages.
Les parcours parallèles – le passage
Militant engagé, dès les années 80, j’ai, parallèlement à mes recherches et sur mon temps libre, conduit une activité d’édition m’impliquant 1) dans les domaines des radios libres (RBS et Tomahawk à Strasbourg, puis Fréquence Gaie à Paris, avec l’émission « Le Navire Night »), 2) dans celui du développement et de la gestion de mnémoniques Minitel du coming-out / jeunes gays 3615 KIKO et de la prévention du VIH dans la communauté gay (CORTO) et ce en synergie avec les principaux groupes / média LGBT dont le groupe Gai-Pied), 3) dans l’édition régionale (en Pays de la Loire, Bretagne et Poitou-Charentes) d’une revue LGBT Toulousaine : « Le chevalier à la Rose » et enfin, 4) dès l’impact grand public d’Internet, dans la création d’un portail de santé (Safeboy.net) reprenant le modèle d’intervention (en ligne) en santé psychosociale et sexuelle développé sur les mnémoniques minitel. Ces expériences de terrain, les activités éditoriales sur les réseaux Transpac puis Internet (portées par l’association Com’on west, dont je suis le président) m’ont amené à 1) acquérir une légitimité dans le domaine des interactions en ligne en lien avec la santé sexuelle des personnes de minorité sexuelle ou de genre, 2) fréquenter les principaux acteurs/éditeurs s’adressant à ces populations en France et au Québec, puis 3) à consolider les financements nécessaires à mes missions, la programmation informatique et à la promotion des différentes éditions du « Net Gay Baromètre ».
Thématique B : La Santé des minorités sexuelles et de genre
Dès les années 2000, la section 39 du CNRS a validé ma demande de changement [2] thématique et mes collaborations scientifiques se sont formalisées en partenariat avec l’Université du Québec à Montréal. À partir de l’année 2002, mes séjours aux départements d’histoire, de géographie puis d’anthropologie et de sexologie de l’Université du Québec à Montréal m’ont permis de définir un nouvel objet de recherche et un projet initial [3]« D’une géographie des homosexualités à l’inscription dans le cyberespace de la population LGBT : usages et recomposition des territoires de visibilité et de rencontres homos et bisexuels au risque du VIH-Sida ». Décliné selon trois thématiques, ce projet aborde : 1) les « champs de liberté » et la construction d’un territoire (modèle théorique sur lequel s’appuie l’approche historique et géographique des services et ressources LGBT en France et au Québec [REF2], 2) le réseau Internet, comme lieu de production de nouveaux services et territoires (typologie, appropriation, usages et pratiques) et, 3) les rencontres en ligne comme de nouvelles formes d’interactions sociosexuelles à l’épreuve du risque [REF3].
Ce travail fait appel à des outils méthodologiques interdisciplinaires et fut validé, entre 2002 et 2006, par plusieurs publications (N=34). Il a conduit au développement d’un progiciel [4] d’enquêtes en ligne (dont interface fut basée sur les technologies PHP/MySQL permettant d’exporter les bases de données constituées dans SPSS et MAP Info pour y effectuer des analyses statistiques et l’analyse spatiale). Cet outil, hébergé sur les serveurs de l’UQAM, a supporté les 8 éditions successives des enquêtes en ligne « Net Gay Baromètre », dont la stratégie [5] de recrutement (quadriennal) permet de réunir environ 20 000 répondants par édition (16 000 en France et 4000 au Québec). Le questionnaire s’est enrichi au fil de ses éditions (possédant aujourd’hui 18 thématiques et 80 écrans) et, par la qualité de son échantillon, est reconnu, en France et au Québec, comme la première étude sur les modes de vie et la santé des minorités sexuelles.
Plus particulièrement, l'enquête propose 9 sections et 18 thématiques, le NGB est l’une des enquêtes les plus exhaustives en ce qui a trait au mode de vie, à la sexualité et à la santé des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et des personnes transgenres, en France, en belgique et au Québec. Plus particulièrement, le questionnaire questionne 1) l’usage de la toile et des réseaux sociaux a) plus général (comprenant le dévoilement de l’orientation sexuelle) et b) à des fins de rencontres, 2) le développement ou maintien de relations sociales, affectives ou sexuelles avec des partenaires rencontrés (ou non) sur Internet, que ces partenaires soient a) de couple, b) occasionnels (féminins et/ou masculins) ou c) dans le cadre du travail du sexe, 3) le dévoilement de l’orientation sexuelle par rapport à l’entourage (famille, amis, collègues, médecin…), 4) les pratiques sexuelles et les comportements sexuels à risque rapportés (dont le « barebacking » et les relations dans le cadre du travail du sexe), 5) la consommation de substances psychoactives, 6) la santé physique et sexuelle, notamment par rapport a) aux tests de dépistage du VIH et VHC, le suivi et l’allégement des traitements, b) à la réduction des risques, la connaissance et l’appropriation de la prévention diversifiée et c) aux IST contractées dans les 12 derniers mois, 7) la santé psychologique, interpersonnelle et sociale, abordée notamment à travers a) l’image corporelle, b) la prise de risque dans la vie en général, c) les sentiments de discrimination ou perceptions d’attitudes négatives face à l’orientation sexuelle/au genre/au statut sérologique au VIH/aux origines ethnoculturelles, etc., le tout mesuré dans un cadre spatial et intersectoriel, d) les préoccupations questionnées par catégories et niveau d’intensité au regard de la santé physique, mentale, relationnelle ou sexuelle, 8) le parcours médical et psychosocial lié au processus de transition des personnes trans ainsi que 9) la santé reproductive et gynécologique des femmes cisgenres et des hommes trans.
L’originalité de mes travaux est donc d’avoir construit un outil d’acquisition de données probantes et de transfert des connaissances sur les minorités sexuelles et de genre, vers les intervenants et organismes œuvrant dans le domaine de la prévention du VIH/SIDA [REF4], du VHC et des toxicomanies [REF5]. Ce profond changement de parcours dans ma carrière me semble positif, m’ayant permis de développer et de maintenir à l’UQAM des relations internationales dans une cadre interdisciplinaire avec plusieurs départements, groupes [6] et chaires [7]de recherche de l’UQAM. Mon statut de professeur [8] associé me permet d’y encadrer de nombreux étudiants en maîtrise de sexologie et de m’impliquer en tant que co-chercheur dans plusieurs projets et réseaux de recherche.
Les publications les plus significatives à ce jour :
REF1 - Léobon A, (1995) La qualification des ambiances sonores urbaines, Revue Natures - Sciences - Sociétés. Volume III, N° 1 1995 p 26 à 41
REF2 - Léobon, A. (2007). De l’espace géographique traditionnel au cyberespace : la construction des territoires homos et bisexuels français, in Julien D., Lévy J.-J., Homosexualité, variations régionales, Presses de l’Université du Québec, p. 238-265
REF3 - Léobon A. (2009). Le corps à l’épreuve du risque. Les expressions minoritaires sur l’Internet gay, Revue Esprit, mars-avril, Casilli A., dir., « Le corps à l’épreuve des cultures numériques », p. 197-207
REF4 - Léobon A., Velter A., Engler K., Drouin M.C., Otis J., 2011, A relative profile of HIV-negative users of French websites for men seeking men and predictors of their regular risk taking: a comparison with HIV-positive users, AIDS Care Psychological and Socio−medical Aspects of AIDS/HIV – AIDS Care, vol.23, n° 1, p. 25-34
REF5 - Léobon A., Dussault E., Otis J., 2018, « Chemsex » chez des hommes français ayant des relations sexuelles avec des hommes, numéro spécial « Drogues et minorités sexuelles », Drogues, santé et société, vol. 17, n°2 P53-75
2021 : un édition LGBTQ+ #COVID-19 des Net Gay Baromètres
L’impact de la COVID-19 est en effet questionné dans l'édition 2021 du Baromètre au regard de : 1) son activité professionnelle, ses revenus, son contexte de vie et son lieu de résidence, 2) sa vie de couple, 3) l'usage du réseau Internet à des fins sociales ou de rencontres, 4) sa sexualité avec des partenaires réguliers ou occasionnels, 5) sa fréquentation des lieux de socialisation et de rencontres LGBTQ+, 6) sa consommation d'alcool ou 7) d'autres substances psychoactives, 8) l'activité éventuelle de travail du sexe. De plus, cette édition aborde 9) la réduction des risques appliquée à la COVID-19 et sa variation selon le contexte relationnel, 10) le stress ressenti en contexte COVID (i.e., en situation de confinement ou de distanciation sociale moins stricte) et 11) l'impact plus global du contexte COVID sur sa santé mentale.
L'édition LGBTQ+ #COVID-19 du Net Gay Baromètre 2021 sera distribuée sur les territoires français, belges et québécois. La poursuite des analyses secondaires permettra de proposer des conférences sur les résultats préliminaires dans des congrès, auprès d’associations et d'autres « utilisateurs de connaissances », et des articles dans des revues.
Transférer les connaissances et mobiliser les communautés
Notre projet 2021-25 mobilise les associations AIDES (pôle recherche communautaire et délégation régionale), SIDA INFO SERVICE (SIS-association) et ACCEPTESS-T, GREY-PRIDE ainsi qu’l’ENIPSE. Il comporte six phases qui visent à : 1) présenter une déclinaison thématique et régionale des principaux résultats issus de l’édition 2018 du Net Gay Baromètre français ; 2) évaluer les besoins de savoir des UC sur certains enjeux ou territoires ; 3) produire, conséquemment, des analyses statistiques secondaires cernant, par exemple, la vulnérabilité ou les besoins en santé de sous-populations clefs, les présenter lors de conférences virtuelles et sur notre application mobile puis discuter de ces résultats pour valider leur pertinence ; 4) enrichir, revisiter les sujets abordés par l’enquête, pour que l’édition 2022-23 réponde aux exigences dégagées ; 5) démontrer que l’ensemble de ce processus de transfert des connaissances nous enrichit collectivement et mobilise nos capacités à couvrir les besoins des associations comme à réduire l’incidence du VIH par une approche syndémique et intersectionnelle de la santé. Tout au long de ce travail, nos équipes de recherche et les associations (UC) impliquées se réuniront pour coconstruire et évaluer les diverses phases de ce projet.
Place de mes recherches dans celle de l’unité (2015-2020)
Le projet scientifique conçu pour 2017-2021 est articulé autour de quatre axes : 1) Production, partage et différenciations des espaces, 2) Pratiques, expériences et représentations des espaces, 3) La construction spatialisée de l’action politique : entre ordinaire et institutionnel et 4) Théories, interdisciplinarités, méthodes. Le projet 2021-25 imposera d'organiser ce travail en suivant les articulations entre AXE et CHANTIER.
Une part importante des populations LGBTQ revendiquent aujourd’hui une égalité de droit et entrent dans un processus de normalisation qui se trouve souvent en contradiction avec les réalités vécues – des indicateurs mesurés à plusieurs niveaux du NGB nous permettent de rejoindre l’axe 1 « PRODUCTIONS, DIFFÉRENCIATIONS ET PARTAGES DE L’ESPACE » qui s’intéresse au processus de différenciations, de la pratique des espaces et de la fabrication de liens par les lieux pour les groupes ou les sous-populations de répondant·e·s les plus marginalisés. Par exemple : 1) les discriminations rapportées le sont au regard des divers espaces où elles s’inscrivent de manière additive ou intersectionnelle ; 2) Le dévoilement de son identité sexuelle ou de genre, associé au fait de rapporter faire corps ou d’être solidaire des communautés LGBTQ+, différentie des groupes de répondant, alors que 3) la fréquentation de certains espaces semble associée à des sous-cultures de sexe distinctes où à des entre-soi en lien avec des pratiques sexuelles à risque ou marginales (ex. : Chemsex).
L’axe 2, « PRATIQUES, EXPÉRIENCES ET REPRÉSENTATIONS DE L’ESPACE » visait à analyser les processus de différenciation sociale et spatiale pour mettre en question la genèse des inégalités, mais aussi des solidarités ou des conflits. Ainsi, l’expérience de la différence et les parcours « en marge » sont souvent confrontés à des formes de violences et de stigmatisation qui sont rapportées dans l’enquête. L’affaiblissement du tissu communautaire au profit d’une « ère numérique dominante » semble impacter le lien social et isoler les individus, dans un contexte de recrudescence des actes homophobes. Ainsi la « communauté » et le collectif pourraient ne plus tenir leur rôle de protection au regard des violences et des discriminations présentes dans l'espace public, mais aussi dans l’entre-soi communautaire.
L’inclusion de la diversité de genre dans nos travaux montre la manière dont les individus composent avec les appartenances, les normes, certaines catégories ou les subissent, alors que nos travaux abondent la question des inégalités sexuelles et de genre en allant explorer les problématiques des groupes les plus exposés (ex. : travailleur·euse·s du sexe, consommateurs de substances psychoactives, personnes vivant avec le VIH, personnes trans, etc.). Du point de vue de l’expérience de l’espace, des effets de lieu et des interfaces, le Baromètre permet de comprendre l’impact des applications mobiles dans la transformation du rapport au risque (en particulier sous l’angle de la santé sexuelle). Au fil des éditions, l’intensification de leurs usages s’est accompagnée d’un éloignement progressif des espaces de socialisation traditionnels et du milieu communautaire. Nous mesurons les dépendances à Internet, au cybersexe, au sextape, et aux échanges sociosexuels en ligne.
L’axe 3, « LA CONSTRUCTION SPATIALISÉE DE L’ACTION POLITIQUE : ENTRE L'ORDINAIRE ET L’INSTITUTIONNEL », sera rencontré sur la question de la régulation du « travail du sexe » ou de la « consommation de substances psychoactives », sources de stigmatisations au sein même de la « communauté ». Une partie de notre enquête interroge aussi les ruptures entre certaines sous-cultures de la sexualité et celle de la prévention, et aborde l’appropriation des outils de réduction des risques et le tournant biomédical de la prévention du VIH. On se doit de signaler ici les nouveaux outils de prévention et de réduction des risques qui ont renforcé le sentiment d’appartenance à de nouvelles identités collectives (ex. : les PrEPeurs, chemsexers, etc.).
L’axe 4, « THÉORIES – INTERDISCIPLINARITÉS – MÉTHODES », est traversé par nos méthodologies de recueil de données et les moyens que nous mettons en œuvre pour promotionner le contenu de nos enquêtes qui appellent à davantage de collaboration entre les chercheurs et les milieux associatifs (tout autant sur le plan du recrutement des participants que dans le transfert des connaissances issues de nos travaux). Nous avons présenté lors de différents séminaires nos travaux, par exemple à propos de notre vision de l'intersectionnalité et des rapports sociaux de domination, mais aussi sur le plan de la protection des données numériques mise en œuvre dans l’interface de programmation et de distribution de l’enquête.
_______________________________
Notes de bas de page
[1] Système d’analyse de contenu des séquences sonores.
[2] Soutenu par l’ANRS – Projet « D’une géographie des homosexualités à l’inscription dans le cyberespace de la population LGBT : usages et recomposition des territoires de visibilité et de rencontres homos et bisexuels au risque du VIH-Sida »
[3] Soutenu en France, par l’Agence nationale de recherche sur le Sida et, au Québec, par le Fond québécois de recherche en sciences sociales.
[4] Déposé comme brevet à l’INPI, le « Net Gay Baromètre » constamment enrichi et amélioré est devenu, au fil du temps, un outil performant permettant de collecter des données.
[5] Des réseaux sociaux aux sites de rencontres traditionnels, la diversification des lieux de recrutement rend compte de l’ensemble du territoire, des diverses cultures de sexe et de classes d’âge
[6] Collaborateur au groupe de recherche interdisciplinaire (psychologie, sexologie, sciences de l’éducation, etc.) de l’UQAM « Sexualité et genre, Vulnérabilité et Résilience » SVR (2008-2015)
[7] Chaire canadienne de recherche en éducation à la santé puis Chaire de recherches sur l’homophobie (https://chairehomophobie.uqam.ca/)
[8] Professeur associé à la Chaire canadienne de recherche en éducation à la santé de 2006 à 2018 et, depuis 2018, au Département de sexologie

