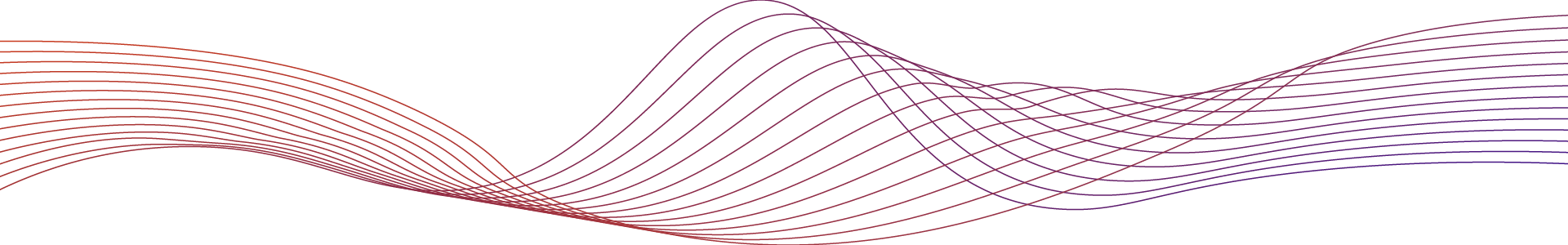
Clément FABRE
Présentation
Orientations générales de recherche Mes recherches se situent au croisement de l'histoire impériale, de l'histoire du corps et des sensibilités et d’une histoire sociale des savoirs. Jusqu’à présent, mes travaux ont principalement porté sur une histoire des impérialismes britannique et français en Chine, des circulations entre l’Europe et la Chine et des savoirs occidentaux relatifs au monde chinois. J’ai abordé cette mise en savoir de la Chine à partir de l’histoire sociale des acteurs qu’elle implique, depuis les sinologues jusqu’aux diplomates, missionnaires et médecins, à partir des politiques d'influence qui la sous-tendent et de la matérialité des objets autour desquels elle se joue. Après un premier terrain de recherche sur l’histoire de la langue chinoise dans la France du XIXe siècle, je me suis intéressé dans ma thèse aux savoirs pratiques développés au sujet des corps chinois par les diplomates, missionnaires et médecins anglophones et francophones déployés en Chine des années 1830 au début des années 1920. Mes nouveaux projets de recherche portent sur l'histoire des traversées maritimes coloniales (XIXe-XXe siècle), sur l'histoire sensorielle des empires coloniaux (XIXe-XXe siècle) et sur une histoire sociale et politique de la voix au XIXe siècle.
Résumé de la thèse « La Chine à fleur de peau : agents d’influence anglophones et francophones en Chine et différence chinoise des corps (des années 1830 au début des années 1920) », sous la direction de Pierre Singaravélou et la co-direction d’Anne Carol (3 vol., 1280 p.), soutenue le 5 novembre 2022. Des années 1830 aux premières années de la République chinoise, services diplomatiques occidentaux et sociétés missionnaires attendent des agents qu’ils déploient dans l’Empire des Qing qu’ils désamorcent la prétendue xénophobie chinoise pour faciliter la pénétration diplomatique, commerciale et évangélique du pays. Cette préoccupation constitue l’accès à l’intimité des populations et des autorités chinoises en enjeu crucial et fait des médecins-missionnaires protestants comme des médecins français détachés auprès du Quai d’Orsay des acteurs importants des politiques d’influence diplomatiques et évangéliques en Chine. C’est à la lumière de ces dernières que ma thèse aborde les savoirs occidentaux sur la différence chinoise des corps. Le décalage entre l’absence de cohérence raciale de la Chine pour l’anthropologie raciale du XIXe siècle et l’essor, tout au long du siècle, de savoirs relatifs aux corps chinois invite en effet à étudier ces derniers, non comme une simple déclinaison de théories raciales, mais à partir même des savoirs pratiques développés sur le terrain par les diplomates, missionnaires et médecins anglophones et francophones que je choisis de désigner comme agents d’influence occidentaux en Chine. Parce qu’on attend d’eux qu’ils sachent interagir, négocier avec des interlocuteurs chinois, les convertir ou les soigner, il leur incombe de déterminer ce que l’écart entre corps occidentaux et chinois leur impose d’ajustements et d’apprentissages. C’est dans l’incorporation même des dispositions qu’il leur faut donc acquérir – depuis la maîtrise de l’étiquette chinoise jusqu’au savoir-faire de la pratique médicale en Chine – que sourdent les réflexions sur cet écart corporel, dont les stéréotypes relatifs aux corps chinois qui se figent progressivement au cours du siècle constituent bien souvent autant de vies posthumes. À les étudier ainsi au plus près de la pratique, on se donne les moyens de saisir ce que les savoirs sur la différence chinoise des corps au XIXe siècle doivent à une diversité de théories savantes autant qu’aux enjeux professionnels et aux ambitions sinologiques qui guident les agents d’influence sur le terrain ; à leur expérience corporelle et sensible de la Chine autant qu’aux processus de co-construction qui mettent en jeu divers types de fixeurs et de savoirs chinois. À l’écart d’une histoire intellectuelle des catégories raciales, ma thèse pose ainsi les jalons d’une histoire pratique des savoirs sur la différence des corps, attentive aux facteurs professionnels, politiques et savants qui informent leur constitution sur le terrain, autant qu’aux transformations qu’ils connaissent en circulant, d’un registre documentaire à l’autre, au sein des empires britannique et français. Thèse récompensée par le Prix Jean-Baptiste Duroselle d’Histoire des relations internationales et par le Prix Dominique Kalifa d’Histoire du XIXe siècle.
Parcours • 2024-2025. Postdoctorat à Sorbonne Université (EHNE). • 2023. Qualification aux fonctions de maître de conférences (section 22). N° de qualification : 23222348905 • 2017-2022. Doctorat d’histoire (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / SIRICE (UMR 8138) / TELEMMe (UMR 7303) / École doctorale 113 : Histoire) Financement : contrat doctoral spécifique normalien (ENS de la rue d’Ulm). Thèse : « La Chine à fleur de peau : agents d’influence anglophones et francophones en Chine et différence chinoise des corps (des années 1830 au début des années 1920) », sous la direction de Pierre Singaravélou et la co-direction d’Anne Carol (3 vol., 1280 p.), soutenue le 5 novembre 2022. Jury : Timothy Brook (University of British Columbia, rapporteur) ; Anne Carol (Aix-Marseille Université, co-directrice) ; Frédéric Obringer (CNRS) ; Antonella Romano (EHESS, présidente du jury) ; Pierre Singaravélou (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur) ; Isabelle Surun (Université de Lille) ; Sylvain Venayre (Université Grenoble Alpes, rapporteur). • 2012-2017. Élève-fonctionnaire à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. Département : Histoire. • 2015-2016. Agrégation externe d’histoire (École normale supérieure de la rue d’Ulm). Rang : 17. • 2013-2015. Master d’histoire contemporaine (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / SIRICE). Mémoire : « Idéogrammes, caquetages et ornements. Paris et la langue chinoise (1814-1900) », sous la direction d’Hugues Tertrais et la co-direction de Pierre Singaravélou, obtenu mention Très Bien. • 2012-2013. Licence d’histoire (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Obtenue avec mention Bien. • 2012-2013. Licence de droit (Université Paris 10 Nanterre). Obtenue avec mention Assez Bien. • 2012. Admission à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. Rang : 29. • 2010-2012. Hypokhâgne puis Khâgne A/L/ (Lycée Louis le Grand, Paris). Spécialité lettres classiques. • 2010. Obtention du Baccalauréat scientifique (Académie d’Amiens). Mention Très Bien et Félicitations du Jury.
Bourses et distinctions • 2024. Prix jeune chercheur.se décerné par l’Association des historiennes et historiens du contemporain (H2C) pour l’article « La poignée de main de l’étameur (Paris, 30 janvier 1887). Une histoire des relations sino-occidentales à hauteur d’interaction », Revue Historique, n° 708, 2023, p. 661-706. • 2024. Prix Dominique Kalifa décerné par le Centre d’Histoire du XIXe siècle (Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Sorbonne Université) et la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révoltions du XIXe siècle pour la thèse de doctorat. • 2023. Prix Jean-Baptiste Duroselle décerné par l’Institut d’Histoire des Relations Internationales Contemporaines pour la thèse de doctorat. • 2020. Bourse de mobilité du programme Alliance, Columbia University (New York). Projet de recherche : “Occidental confrontations with China during the 19th century” • 2019. Bourse de voyage du GIS Asie. Participation à la 20e édition de l’International Convention of Asia Scholars (ICAS) à Leyde. • 2016. Prix d’Histoire du XIXe siècle décerné par le Centre d’Histoire du XIXe siècle (Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Sorbonne Université) et la Revue d’histoire du XIXe siècle (Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révoltions du XIXe siècle) pour le mémoire de Master 2.
Responsabilités scientifiques • 2020-2025. Membre du comité scientifique de la revue L’Histoire. • 2021-2025. Membre du comité éditorial de la revue Entre-Temps. • 2023-2025. Membre du Comité Histoire des Langues O’ présidé par Emmanuel Lozerand. • 2025. Membre du jury du Prix d’Histoire du XIXe siècle décerné au meilleur mémoire de Master 2 par le Centre d’Histoire du XIXe siècle et la Revue d’histoire du XIXe siècle. • 2023. Expertise d’article pour Monde(s). Histoire, Espaces, Relations. • 2023. Expertise d’article pour Medical History. • 2022. Participation au jury du Prix Mnémosyne. • 2022. Expertise d’article pour la Revue d’histoire culturelle, XVIIIe-XXIe siècles. • 2019-2020. Membre du bureau de la Société française d’histoire des outre-mers. • 2018-2020. Membre du conseil d’administration de la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle.
Publications
Publications
Les Mondialisations des années 1880 au milieu des années 1930Atlande, 2023
Ouvrages
hal-04338450
v1
|
|
Lire les corps" numéro spécial, n° 123, Genèses2021
Ouvrages
hal-03553488
v1
|
Race et corps dans l'ordinaire colonial (numéro spécial)Monde(s). Histoire, Espaces, Relations, 24 (2), pp.7-159, 2023
N°spécial de revue/special issue
hal-04387841
v1
|
|
|
|
L’aveu des corpsHypothèses, 23 (1), pp.231-300, 2022, ⟨10.3917/hyp.191.0231⟩
N°spécial de revue/special issue
hal-04337642
v1
|
Lire les corpsGenèses. Sciences sociales et histoire, n° 123 (2), pp.3-89, 2021, ⟨10.3917/gen.123.0003⟩
N°spécial de revue/special issue
hal-04337646
v1
|
29 août 1842. Le traité de NanjingMichel Catala; Stanislas Jeannesson; Erick Schnakenbourg. Les Européens et la mondialisation du XVe siècle à nos jours, Presses universitaires de Rennes, pp.225-227, 2023
Chapitre d'ouvrage
hal-04338405
v1
|
|
Bouleversements géopolitiques, conquêtes, ouvertures, circulations, présences en France, de 1860 à 1914Musée national de l’histoire de l’immigration / Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais. Immigrations est et sud-est asiatiques depuis 1860. Catalogue de l’exposition du Musée national de l’histoire de l’immigration, 10 octobre 2023-11 février 2024, pp.21-31, 2023
Chapitre d'ouvrage
hal-04338399
v1
|
|
14 août 1900. L’entrée des troupes de l’Alliance des Huit nations dans PékinPresses universitaires de Rennes. Les Européens et la mondialisation du XVe siècle à nos jours, pp.255-257, 2023
Chapitre d'ouvrage
hal-04338416
v1
|
|
Les Chinois sont fourbesHistoire des préjugés, Les Arènes, pp.79-85, 2023, 1037508394
Chapitre d'ouvrage
hal-04046601
v1
|
|
Février 1856. Les effets de l’opiumCNRS Éditions. Chroniques de l’Europe, pp.116-120, 2022
Chapitre d'ouvrage
hal-04338438
v1
|
|
La viande de chienL’Épicerie du monde. La mondialisation par les produits alimentaires, du XVIIIe siècle à nos jours, Fayard, pp.399-403, 2022
Chapitre d'ouvrage
hal-04338429
v1
|
|
Les baguettesLe Magasin du monde. La mondialisation par les objets, du XVIIIe siècle à nos jours, pp.116-120, 2020
Chapitre d'ouvrage
hal-02933632
v1
|