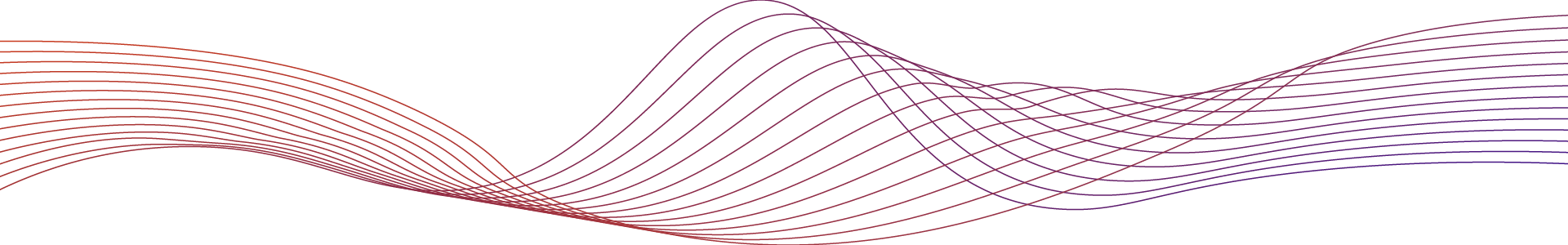
Présentation
Thèmes de recherche :
- Sociologie de la santé et de la médecine
- Sociologie du travail et des professions
- Sociologie de la domination
- Sociologie du genre
- Sociologie de l’avortement
Thèse : Les médecins et l'avortement. Sociologie de la domination médicale
Sous la direction de Maud Gelly et Anne Paillet, en Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP)
Soutenue le 11 décembre 2024 à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Prix de thèse du Défenseur des droits 2025
Résumé : Comment une jeune médecin de centre d’IVG en arrive à imposer un examen gynécologique à une femme malgré ses protestations ? À prétendre que l’avortement peut causer l’infertilité pour la convaincre d’accepter une contraception ? Elle a appris, au cours de ses études, à être médecin, c’est-à-dire non seulement à ausculter et à opérer, mais aussi à occuper une position de pouvoir. Au croisement d’une sociologie structurale du travail et d’une sociologie de la domination, à partir de l’étude de la prise en charge de l’avortement, cette thèse propose d’analyser empiriquement et conceptuellement la domination médicale, ses formes concrètes, sa banalisation, sa reproduction et ses transformations. Elle s’appuie sur une enquête combinant six mois d’observation comparative du travail médical dans trois centres d’IVG, des entretiens menés auprès de 133 professionnel·les de santé et l’analyse secondaire des données statistiques du volet « Médecins » de l’enquête Fécond (INSERM-INED).
Cette recherche retrace la genèse de l’espace professionnel de l’avortement après la loi Veil, l’évolution des (in)dispositions et des prises de position des médecins qui le composent, et les luttes professionnelles dont la délégation du travail et la revendication de l’expertise en matière d’avortement font l’objet. En particulier, elle détaille les trajectoires sociales des « avorteurs » et « avorteuses », médecins militant·es – pour certain·es – qui se spécialisent dans le travail d’avortement. Elle ouvre la boîte noire des inégalités liées au recours à l’avortement en montrant comment le travail médical participe à les produire : l’accès à l’avortement, mais aussi la qualité des soins prodigués, varient considérablement selon les médecins, les services dans lesquels les femmes font leur demande et la position qu’elles occupent dans les rapports de classe, de race, de genre et d’âge. L’enquête montre les logiques pratiques du travail médical et les enjeux professionnels qui expliquent le maintien de parcours longs et complexes malgré l’assouplissement du dispositif légal d’encadrement de l’IVG depuis une cinquantaine d’années, et elle détaille les pratiques individuelles et collectives par lesquelles les médecins contrôlent les modalités des soins alors que la loi les place pourtant dans une position de prestataires de services. En définitive, cette thèse éclaire les socialisations médicales sous un nouvel angle, celui de l’intériorisation de positions dans un rapport de domination, c’est-à-dire, pour les médecins, de manières d’exercer le pouvoir et de s’y sentir légitimes, et, pour les profanes, de dispositions à s’y soumettre.
Mots-clés : Avortement, IVG, pouvoir médical, travail hospitalier, inégalités de santé, genre, violences gynécologiques, socialisation médicale.
Domaines de recherche
Publications
Publications
Les oppositions contemporaines autour de l’avortementRevue française de sociologie, 1, 2025
N°spécial de revue/special issue
hal-05393600
v1
|
|
Violences médicalesGenèses. Sciences sociales et histoire, 1 (138), 2025
N°spécial de revue/special issue
hal-05211995
v1
|
Mazan. Anthropologie d’un procès pour violsLe bruit du monde, 2025, 978-2-38601-085-9
Ouvrages
hal-05296345
v1
|
|
Le choix d'avorter. Contrôle médical et corps des femmesAgone, 2025, Contre-Feux, 2748905806
Ouvrages
hal-05060524
v1
|
|
|
Tribune : L’avortement est un droit qu’il ne suffit pas de défendre, mais qu’il faut continuer à conquérir2025
Article de blog scientifique
hal-05060522
v1
|
|
|
Les médecins et l'avortement. Sociologie de la domination médicaleSociologie. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2024. Français. ⟨NNT : ⟩
Thèse
tel-05397821
v1
|