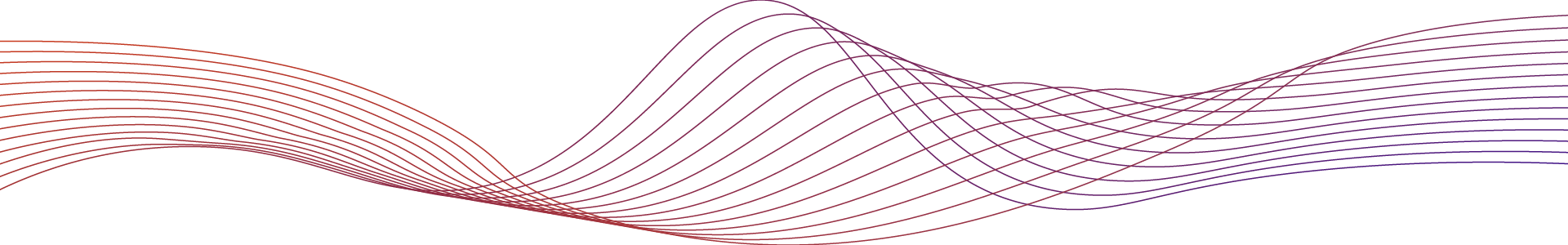
Isabelle Brancourt
- Institut d'histoire du droit Jean Gaudemet (IHD)
Présentation
État civil
Nom : BRANCOURT Nom de jeune fille : STOREZ
Prénoms : Isabelle Marie Pia
Date de naissance : 5 mai 1957 à : Neuilly-sur-Seine Nationalité : Française Situation de famille : veuve (un fils, André)
Adresse personnelle: La Croix d’Épine, 9 route des Moulins, 61170 Saint-Agnan-sur-Sarthe. Téléphone : 02 33 26 24 20 ou 06 03 92 80 41. e-mail : isabelle.brancourt@sfr.fr ou isabelle.brancourt.ext@culture.gouv.fr ou isabelle.brancourt@cnrs.fr
Fonction et grade : Chargée de Recherche Hors Classe au C.N.R.S (CR-HEB). Entrée comme CR1 au 1er nov. 2000. Directrice adjointe du département Centre d'Etude d'Histoire juridique de l'IHD Jean Gaudemet (UMR 7184)
Affectation : - à partir du 1er janvier 2019, à l’Institut d’Histoire du Droit Jean Gaudemet (IHD. UMR 7184, Université Paris II-Panthéon-Assas – C.N.R.S.).
- du 1er janvier 2012 jusqu’à la fin de l’année 2018, à l’Institut d’Histoire des représentations et des idées dans les Modernités [IHRIM-ENS-Lyon. UMR 5317. Direction Olivier Bara] par fusion (depuis le 1er janvier 2016) du Centre d’Études en Rhétorique, Philosophie et Histoire des Idées (CERPHI), département de l’Institut d’Histoire de la Pensée classique (IHPC. UMR 5037, ENS-Lyon - C.N.R.S. Direction Pierre-François Moreau) avec l’UMR LIRE, opérée pour la contractualisation 2016-2020.
- du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2012 : à l’Institut d’Histoire du Droit (IHD. UMR 7184, Université Panthéon-Assas-Paris II – C.N.R.S., dans le département : Centre d’étude d’histoire juridique (C.E.H.J., Archives Nationales).
Concours
1986 : reçue 9ème (sur 600) au C.A.P.E.S. théorique d’Histoire et de Géographie (première candidature). 1986 : reçue 39ème (sur 75) au concours d’Agrégation d’Histoire (première candidature). 2000 : reçue 2e (sur 52) au concours CR1 d’entrée au CNRS (première candidature). 2006-2013 : 9 candidatures au concours DR2 (7 en section 36 de 2006 à 2012), 2 en section 35 en 2012 et 2013), avec un classement en 2008 (9e pour 5 postes, 4 pourvus), en 2011 (14e pour 7 postes), en 2012 (9e pour 5 postes). Abandon des candidatures pour raisons personnelles.
Diplômes et titres universitaires. Qualifications
2005 (3 décembre) : Habilitation à diriger des recherches. Université de Paris 1 Sorbonne-Panthéon. Qualification sur la liste des Professeurs d’université en 2006 (première demande). Titre du dossier : « Le Parlement de Paris au risque de ses archives : le Parquet, le greffe, la cour ». Jury mixte Histoire du droit/Histoire-Lettres. Directeur de recherche : Nicole Lemaître*.* Ego-histoire publiée sur HAL Id : tel-01006136, version 1, https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01006136 Qualification sur la liste des Professeurs d'Université (2006).
**1992 (**1er février) : Doctorat (nouveau style) de l’Université de Lille III. Titre de la thèse : Le chancelier d’Aguesseau. Étude biographique. Spécialisation : Histoire des idées politiques. Mention « Très honorable » avec les félicitations du jury à l’unanimité. Sous la direction du doyen Jean de Viguerie. Qualification sur le liste des Maîtres de conférences en 1992 (première demande)
1987-1988 : cursus libre de DEA d’Histoire du droit à l’université Paris 2-Panthéon-Assas.
1981 : DEA d’Histoire moderne à l’Université d’Angers (note : 18/20, au mémoire). 1980 : Maîtrise d’Histoire moderne à l’Université d’Angers (note : 19/20 au mémoire). 1978 : Licence d’Histoire-Géographie de l’Université Paris IV-Sorbonne. 1975 : Baccalauréat Littéraire Section A3 (mathématiques à l’écrit), mention Bien.
Langues étrangères : espagnol (connaissance et pratique depuis l’âge de 7 ans, remise à niveau en 2016-2017), anglais (connaissance renforcée par des stages 2008 et 2009, des formations et par la lecture. Remise à niveau demandée pour 2018), latin (niveau scolaire 6e-Ter).
Activités d’enseignement jusqu’à mon accession au poste de maître de conférences
*1982-1991 : professeur d’histoire-géographie au Lycée privé (sous contrat d’association) Saint-Louis-de-Gonzague, 12 rue Franklin, 75116 Paris. J’ai tout au long de ces années donné des enseignements dans différentes universités et instituts d’enseignement supérieur (TD et CM).
*1991-1992 : Agrégée contractuelle sur un poste de PRAG à l’Université de Lille III-antenne d’Arras. T.D. d’Histoire moderne de 1ère année de D.E.U.G.
*1992-1993 : Professeur Agrégé (PRAG) à l’Université d’Artois. J’ai assuré dans ce poste aussi bien des enseignements d’histoire moderne (T.D. de D.E.U.G, C.M. et T.D de Licence) que des cours d’Histoire médiévale (C.M. et T.D semestriels en Licence) et d’Histoire contemporaine (auprès des géographes). Ces enseignements embrassaient un éventail de sujets du XIVe au XXe siècle.
Activités d’enseignement et de recherche après mon accession au poste de Maître de conférences (1993-1998)
Recrutée sur un poste d’histoire moderne à l’Université d’Artois, j’ai assuré, à partir de l’année 1993-1994, des enseignements de D.E.U.G, de Licence, de maîtrise et de D.E.A., enfin de préparation au C.A.P.E.S. Les thèmes principaux des cours ont été : l’Europe, de la monarchie absolue à sa remise en cause (XVIIe et XVIIIe siècle), la France des XVIIe et XVIIIe siècles, sans exclure la participation à des modules divers sur la période moderne. En maîtrise et D.E.A., les séminaires étaient les fruits de mes recherches. J’ai assuré, sous le contrôle d’Alain Lottin, le tutorat des maîtrises. Pour la préparation au C.A.P.E.S, j’ai assuré l’introduction générale à la préparation (méthodologie du concours) et les T.D. d’histoire moderne (la France des Lumières).
Responsabilités : En 1993-1994, j’ai été chargée à l’Université d’Artois de la mise en place et de la coordination de la préparation au C.A.P.E.S d’Histoire-Géographie. À ce titre, j’ai assuré la liaison entre l’université et l’I.U.F.M. du Nord-Pas-de-Calais. La même année, j’ai participé à l’élaboration de la maquette officielle d’une Licence «Lettres-Histoire» destinée à faciliter aux étudiants la préparation du concours des Écoles. À partir de 1995, j’ai fait partie de la commission des spécialistes de l’Université d’Artois, puis à partir de 1997, de l’Université du Littoral (Boulogne-sur-Mer), jusqu’à mon entrée au CNRS.
1998-2000 : délégation au C.N.R.S.
Ma délégation au C.N.R.S., à partir de septembre 1998, dans le cadre du Centre d’Étude d’Histoire Juridique, m’a permis de travailler sur le parquet du parlement de Paris aux XVIIe et XVIIIesiècles et ses magistrats. J’ai étudié le fonds des archives des conclusions du procureur général du parlement de Paris. J’ai ainsi mené de front l’analyse du fonds des conclusions, la découverte du monde des substituts dont j’ai entrepris l’étude dans une optique prosopographique et sociologique, enfin la mise en œuvre de l’édition annotée et commentée des Mémoires (inédits) du conseiller Le Boindre (1650-1652). Dans la logique de ces travaux, j’ai conçu, en vue du concours externe de chargé de recherche (C.R.1)(session de printemps 2000), le projet qui, sur la base d’un inventaire et de l’indexation des quelque 900 minutes des conclusions du procureur général, en fonction d’une grille d’analyse prédéterminée, et devant l’inaccessibilité persistante des archives et l’extrême pauvreté de la bibliographie sur la procédure du parlement aux XVIIe-XVIIIes. (surtout civile), devait proposer la constitution d’un corpus de données tirées des registres et minutes de la cour afin de promouvoir une véritable science pratique de la procédure civile et criminelle dans le dernier siècle de l’Ancien Régime. Ce projet devait être réalisé par étapes successives. Ce cycle de travail a été marqué par ma participation à la journée d’étude organisée par les Archives nationales : « Écrire l’histoire du règne de Louis XIV », du 5 mai 1999, à laquelle j’ai contribué, en collaboration avec Arlette Lebigre, sur le sujet suivant : Un registre récemment identifié aux Archives Nationales : les conclusions du procureur des Grands Jours d’Auvergne. Plusieurs publications ont été le résultat de ces travaux.
À partir de 2000 : activités depuis mon accession au poste de CR1
Outre les activités de recherche qui sont la réalisation progressive du projet que j’ai présenté au concours du printemps 2000 et dont la liste de mes publications établit le bilan, j’ai veillé constamment, d’un institut à l’autre, et surtout de projet quadriennal puis quinquennal à l’autre, d’abord à inscrire mes travaux dans les perspectives évolutives des unités de recherche auxquelles j’ai appartenu, ensuite à adapter mes propres orientations/réorientations aux objectifs, parfois nouveaux et novateurs (diffusion et valorisation facilitées par les archives ouvertes, par l’ouverture précoce d’un carnet de recherche sur Hypothèses.org), qui nous ont été fixés au niveau de l’INSHS en général, au niveau des sections du CnCNRS, actuellement de la section 33 à laquelle j’appartiens depuis la fin de l’année 2014, en provenance de la section 36. J’ai participé, dans le cadre du CNRS, à plus de quarante-huit colloques, congrès ou journées d’étude ; dans le même temps, j’ai entrepris de compléter ma formation dans des domaines techniques liés à la valorisation des recherches ainsi qu’en langues étrangères ; j’ai également et progressivement repris des activités annexes d’enseignement ; j’ai enfin été amenée très vite à encadrer les recherches d’étudiants, doctorants ou non, et de chercheurs. Pour plus de détails, voir infra.
Responsabilités institutionnelles au sein du CNRS : Mon implication dans la vie du CNRS s’est concrétisée, depuis 2010, dans ma candidature et ma nomination comme déléguée SNCS du personnel au Comité Spécial Hygiène et Sécurité (CSHS) de la Délégation Paris A, en mars 2010. Ont suivi deux sessions de formation (avril et mai 2010) et ma participation aux Conseils biannuels (Ivry. octobre 2010, avril et octobre 2011). Cela a impliqué un travail d’information et de transmission de cette information auprès des laboratoires, à commencer par l’IHD auquel j’appartenais alors, également ma participation à des enquêtes de la Délégation et de la DRH sur le travail au CNRS (travail isolé, condition des handicapés, rôle et perception des services sociaux du CNRS par les usagers, etc.). Mon changement de laboratoire ayant entraîné mon changement de délégation, de Paris A à Rhône-Auvergne, j’ai quitté le CSHCT de Paris A pour poser ma candidature à la délégation syndicale titulaire au Conseil national supérieur des Personnes handicapées (CNSPH) auquel j’appartiens donc depuis le début de 2015 (participation active aux conseils biannuels, ainsi qu’à toutes les manifestations liées à l’intégration et à la promotion de la condition des personnes handicapées au CNRS).
De juin 2017 à janvier 2019, membre suppléant du Comité de suivi des thèses de l’École doctorale 3LA de l’Université de Lyon.
II – BILAN DE MON ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE
J’ai construit ma carrière comme une fusée à étages, l’élaboration de chacun des « étages » créant les conditions de l’étape ultérieure. J’ai accumulé ainsi, tant par mes formations initiales que par l’apprentissage des métiers de l’enseignement et de la recherche, des compétences et une expérience diversifiée. Professeur d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire dès l’achèvement de mon cursus universitaire, au cours duquel j’ai été recrutée comme monitrice allocataire, j’ai assuré les bases de mon métier en candidatant aux concours de CAPES et d’Agrégation d’histoire, la même année avec succès (1986), tout en m’impliquant, dès 1982, dans des TD auprès de différents professeurs de l’enseignement supérieur, dans différentes institutions universitaires, et sur des périodes variées de l’histoire (moderne surtout, mais aussi médiévale et contemporaine). L’étape suivante logique a donc été celle de mon doctorat (élaboré tout en travaillant) et de mon entrée dans l’enseignement supérieur (dès 1991), d’abord comme PRAG, puis comme maître de conférences (1993). Seules des circonstances géographiques et familiales m’ont incitée à passer de l’Université au CNRS. Après une délégation réussie, de deux ans, au CEHJ spécialisé en histoire du droit et de la justice au Parlement de Paris (dir. J.M. Carbasse), j’ai tenté le concours CR pour y rester, donc dans la section à laquelle cette unité était rattachée. Je peux me prévaloir d’avoir conduit mon activité à la satisfaction constante de mes professeurs, directeurs, supérieurs hiérarchiques et recruteurs, comme en atteste, d’une part mon recrutement précoce comme monitrice allocataire (dès 1979), d’autre part les lettres de recommandation jointes en annexe n°1.
Depuis mon entrée au CNRS, je n’ai cessé de poursuivre un même objectif scientifique : me situer à un carrefour épistémologique sur le thème de l’exploitation des archives judiciaires et privées du Parlement de Paris, à l’époque moderne dans une perspective historique et juridique, d’abord ; puis, plus largement, littéraire, sociologique, idéologique et philosophico-politique. Mon entrée, dès ma délégation au CNRS, dans une équipe de juristes et l’aspect juridique des recherches poursuivies expliquaient mon rattachement à la section 36 du CoNRS. Depuis 2015, mon entrée dans la section 33 s’est confortée, techniquement, de la dématérialisation progressive des papiers, documents et archives dont l’analyse constitue le centre de mes projets, de l’ouverture de mes recherches à des problématiques plus générales, plus « littéraires » aussi. De l’histoire de la justice et de la procédure à celle de la société de la « Robe » et à l’étude de la philosophie politique sous-jacente, mes travaux et le développement de coopérations et de collaborations m’assurent, par ailleurs, la réussite de l’adaptation de mon programme aux axes de ma très dynamique équipe[1]. Je me suis faite, depuis longtemps, l’avocate d’une politique résolue de collaboration en réseaux de laboratoires qui travaillent des problématiques proches, avec des regards différents mais complémentaires. Ma place confortée au sein de l’IHRIM m’a offert l’occasion d’une autre forme d’interdisciplinarité dont les derniers projets et manifestations scientifiques auxquels j’ai participé, démontrent assez le caractère collectivement prometteur et personnellement stimulant.
Les points forts de mon parcours scientifique me paraissent au nombre de quatre :
1) la cohérence dans la diversité de mes recherches : de l’étude de la vie, de l’œuvre et de la pensée du chancelier Henri François d’Aguesseau à la connaissance des pratiques, des procédures, de la justice et du personnel du Parlement de Paris, le fil conducteur de tous mes travaux est celui d’un univers d’une exceptionnelle richesse, celui de la grande Robe d’Ancien Régime, de son patrimoine mental et intellectuel, de son rôle historique, juridique et politique dans l’évolution de la France moderne, du caractère fondateur de nombre de ses principes, tant dans le domaine du droit que dans celui des idées politiques qui se sont transmises jusqu’à nous. La diversité est temporelle et conceptuelle, la compréhension du Parlement de Paris moderne ne dispensant ni de remonter jusqu’aux origines, donc au Moyen Âge, ni de comparer avec les autres parlements et cours souveraines de la France moderne, ni de passer de sources mémorielles à des sources théoriques (en droit comme en philosophie). Dès lors, mes travaux ont bénéficié de la participation à de très nombreux échanges, souvent interdisciplinaires, et très largement internationaux (avec des collègues américains, italiens, britanniques et espagnols, principalement, ponctuellement allemands, belges ou suisses).
2) l’adaptation aux problématiques contemporaines : tant sur le plan scientifique qu’idéologique, les interrogations de notre génération ne m’ont jamais laissée indifférente ; elles ont même largement contribué à orienter mes travaux de façon à participer aux débats publics d’aujourd’hui et à contribuer, dans mes enseignements, si modestement que cela paraisse, à préparer la génération suivante à y faire face et à trouver d’éventuelles solutions. J’ai ainsi été successivement, ou alternativement, mobilisée par la réflexion : - autour de la naissance et de la nature de l’État, et donc des relations entre les pouvoirs (politique, législatif, judiciaire), pour une distinction claire entre des notions proches, trop souvent confondues ou pensées comme interchangeables : pouvoir, gouvernement, autorité, puissance (cf. groupes de recherche B. Guené-A. Rigaudière-J. Krynen-J.-Ph. Genêt[2] pour le Moyen Âge, Y.-M. Bercé-R. Descimon et A. Guerreau, J. Cornette, ou B. Vonglis, pour les temps modernes, et pour ne citer que les principaux) : cette problématique oriente largement mes travaux sur d’Aguesseau, sur la Fronde, sur les translations du Parlement de Paris, sur l’évolution du regard des juristes sur la noblesse (entre le XVIe et le XVIIIe siècle), sur les origines d’un « conservatisme » à la française ; - autour de l’indépendance de la justice et du rôle du ministère public dans la distribution de la justice, les nécessaires évolutions ou progrès de la procédure pénale (un thème d’intérêt général depuis les années 1993-2003, et spécialement depuis un certain nombre de scandales judiciaires très médiatisés) : c’est toute l’actualité de mes travaux sur le parquet du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, sur le monde des substituts du Procureur général du roi (tout à fait pionniers en 1999), aujourd’hui sur le greffe de cette institution hors-norme (et la découverte de ses archives, depuis 2010 surtout).
3) la précocité de mon entrée dans l’univers technologique de notre temps : de la simple utilisation de l’ordinateur personnel (traitement de texte, dès 1987) à l’apprentissage des logiciels spécialisés dans le stockage et le traitement des données (Excel et métrologie dès 1993, bases de données dès 2002, dont Access à partir de 2008) ou dans la facilitation de l’enseignement et de la communication scientifique (PowerPoint dès 2002).
4) le pari dès 2009 sur les Humanités numériques : en témoigne le lancement en février 2009, dès la première information en ce sens (intervention de Pierre Mounier, Délégation Paris A, Ivry, janvier 2009), de mon Carnet de recherche Parlement(s) de Paris et d’ailleurs. Chronique des recherches dans des archives hors-norme, sur Hypothèses.org, dans les vingt premiers de ce portail du CLEO qui en compte aujourd’hui plus du millier. À partir de ce moment, j’ai constamment approfondi les potentialités (rapidité, flexibilité, internationalité, etc.) du numérique pour la diffusion de recherches comme les miennes, qui, reposant sur des archives absolument incroyables en qualité comme en quantité, et une historiographie toute aussi monumentale, nécessitent des moyens aussi exceptionnellement efficaces de collecte, de classement, d’indexation et de diffusion de l’information.
L’originalité de mon cursus est institutionnelle et scientifique : - elle réside d’abord dans les fonctions exercées et la manière de les accomplir : en quarante ans, je suis passée de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur puis à la recherche à temps plein. J’ai parcouru pratiquement tous les niveaux d’enseignement, du collège au Master et à l’encadrement du doctorat, avec un plaisir sans restriction à tous les niveaux, et donc avec succès. Je n’ai jamais perdu le contact avec la recherche au cours de mes années d’enseignement, même secondaire. De même, je n’ai jamais perdu de vue l’enseignement, même scolaire, depuis mon entrée au CNRS comme chargée de recherche. Je suis donc impliquée dans les débats contemporains qui agitent le monde de l’Éducation nationale et de l’ESR, tant auprès des syndicats qu’au niveau associatif.
L’originalité scientifique de mes recherches me semble résider en 3 points :
1) Autour de d’Aguesseau, d’abord, je m’honore d’avoir osé, malgré les hésitations même d’une personnalité telle que Roland Mousnier, rompre l’exclusivité de la méthode sociologique, sérielle et structurelle pour le choix de mon sujet de thèse, dont l’intitulé fut « Le chancelier d’Aguesseau. Essai biographique » : en février 1992, j’étais donc, en France, et depuis quelques lustres, l’une des premières personnes à proposer en doctorat une approche biographique. C’était soutenir que l’individuel, la personnalité de quelqu’un en particulier, son éducation, sa carrière, sa pensée et ses idées (Henri François d’Aguesseau, 1668-1751), pouvaient permettre une rénovation du regard historiographique sur une institution, si importante soit-elle (le Parlement de Paris ou le Conseil du roi), sur une époque, si complexe soit-elle (le temps de la « crise de la conscience européenne », « de Colbert à l’Encyclopédie »). Sur ce terrain, j’ai rejoint sans le savoir alors des recherches de collègues anglo-saxons de la génération précédente (Orest Ranum, sur Bouthillier de Chavigny ; John Rogister sur le comte d’Argenson) ; j’ai été rapidement rejointe par d’autres jeunes collègues (Françoise Hildesheimer sur Richelieu, Olivier Chaline sur Godard de Belbeuf, Gauthier Aubert sur le Président de Robien, etc.) alors que dès 1996, la biographie scientifique revenait à l’honneur des congrès historiques (AHMUF).
2) Aux risques d’un fonds d’archives hors du commun, ensuite (la monumentale série X du Parlement de Paris aux Archives nationales de France, la première d’Europe dit-on, i.e. quelque 30.000 articles – registres ou cartons), je me suis lancée à l’assaut de la partie moderne pour une exploitation méthodique qui permette de construire un pont épistémologique entre l’histoire et le droit sur le thème de l’exploitation scientifique des actes du Parlement de Paris pour une histoire renouvelée de la justice civile et criminelle des XVIIe-XVIIIe siècles. Alors que les travaux, parfois remarquables, des générations antérieures d’historiens (Ch. Desmaze, E. Fayard, Félix Aubert…, jusqu’à Philippe Payen) ont contourné la redoutable série des archives authentiques de l’institution, pour privilégier le Fonds Joly de Fleury, à la BnF, ou des copies anciennes, ou bien se sont concentrés sur les archives médiévales, au volume incomparablement plus abordable avant une inflation,constatée dès le milieu du XVIe siècle par Jean Du Tillet (Édouard Maugis, Pierre Timbal et ses collaborateurs du CEHJ, Claude Gauvard, et tant d’autres). La plupart des historiens ont ratissé les espaces plus séduisants, il faut le dire, de la littérature mémorielle, des correspondances, des sources littéraires. Malgré les guides fournis par les archivistes, dès la 2e moitié du XIXe siècle, il fallait un brin d’inconscience pour affronter la masse, les obscurités et la paléographie des registres et minutes de la série X. J’ai réussi à entrer dans leur familiarité (encore relative) en découvrant, et en le suivant, un guide de l’époque dont les archives reposaient dans la série U, peu exploitées faute de l’identification précise de leur auteur, un simple commis du greffe, Jean Gilbert, surnommé « de L’Isle ».
3) Pour une conciliation des inconciliables, je crois avoir été, du moins explicitement, l’un des premiers auteurs en histoire de la France moderne, à oser, preuves archivistiques à l’appui, une hypothèse nouvelle sur la nature et les formes (intellectuelles et institutionnelles) de l’évolution de la monarchie française, précisément d’Henri III à Louis XVI : c’était l’affirmation, entre les tenants du Roi et les partisans du Parlement, d’un processus partagé de « constitutionnalisation » du régime politique à l’heure des rois « de droit divin », « de gloire » et de « raison d’État », et au sens moderne de la « constitution ». De façon intuitive à la fin de mes travaux de thèse, puis en 2005, à travers l’étude multiséculaire des crises politico-militaires qui avaient entraîné les translations du Parlement de Paris dans des villes de province (Poitiers, XVe siècle ; Tours, au XIVe siècle, Pontoise, 3 fois, et Troyes aux XVIIe-XVIIIe siècles), il m’est apparu clairement que la « juridicisation » du politique, progressive à partir de Bodin dans les milieux de la robe. Avec d’Aguesseau, par ex., on assiste à la promotion d’un État moderne et monarchique, juridiquement établi (encore en des modes de relations imprécises), sur une distinction croissante des pouvoirs (politique – donc exécutif et militaire, législatif, judiciaire, administratif) jusque-là indistincts. Non sans hésitations, il est vrai, la doctrine monarchique introduit une progressive attribution – exclusive ou à prétention d’exclusivité – au roi seul, ou, au contraire, aux uns ou aux autres, de leur exercice. Ce régime, tout royal qu’en soit le détenteur, tend ainsi à reposer sur les bases décidément modernes, sur une « raison », du moins des conceptions rationnelles (voire rationalistes) de la société de l’Homme et de ses droits. Au contraire l’État royal qui s’est développé peu à peu à partir du XIIIe siècle – et le Parlement y contribue essentiellement (cf. Jean Hilaire) – avec la renaissance du droit romain impérial (Jacques Krynen), reposait sur une fondamentale et « naturelle » adaptation aux circonstances, élaborant ainsi un corps de pratiques politiques coutumières où la réponse pragmatique prévaut sur la solution juridique. Dès lors, au XVIIIe siècle, « Roi » et « Parlement » se servent, à front renversé, de la même conception juridique de la souveraineté (cf. mes travaux sur le lit de justice de 1787).
[1] Voir : http://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/ Je participe aux axes 1, 3 et 4.
[2] Cf. http://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1997_num_118_1_3219
Domaines de recherche
Compétences
Publications
Publications
Henri François d'Aguesseau. Magistrat, chancelier et législateurIsabelle Brancourt; Pascal Plas. Mare et Martin, pp.321, 2022, Grands personnages, Fabrice Defferard, 978-2-84934-594-8
Ouvrages
halshs-03760052
v1
|
|
Au cœur de l’ÉtatIsabelle Brancourt. Classiques Garnier, 20, pp.431, 2020, Constitution de la modernité, Jean-Claude Zancarini, 978-2-406-09785-3. ⟨10.15122/isbn.978-2-406-09785-3⟩
Ouvrages
halshs-01976499
v1
|
|
Un Gilbert méconnu. Magistrature et quotidien du Parlement de Paris dans le premier XVIIIe siècleSociété française d'étude du dix-huitième siècle, 2016, Collection Dix-Huitième Siècle, Hélène Cussac; Marcel Dorigny, 979-10-92328-07-3
Ouvrages
(édition critique)
hal-01422877
v1
|
|
Le Régent, la Robe et le commis-greffierIsabelle Brancourt. Association des Amis de Guy Augé, pp.359, 2013, Hors série N° 1, Jean-Pierre Brancourt
Ouvrages
(édition critique)
halshs-00815650
v1
|
|
Une histoire de la mémoire judiciaireEcole des Chartes, pp.399, 2009
Ouvrages
halshs-00582632
v1
|
|
Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècles)Isabelle Brancourt. Librairie Honoré Champion - Slatkine, 841 pp., 2007, Histoire et archives, Françoise Hildesheimer, 978-2-7453-1681-3
Ouvrages
(ouvrage de synthèse)
hal-04065087
v1
|
|
CORPUS, revue de philosophieIsabelle Storez-Brancourt. Centre d'Études d'Histoire de la Philosophie Moderne et contemporaine. Université Paris X, pp.5-34, 2007, Martine Markovits
Ouvrages
hal-00273428
v1
|
|
« Dire le droit : normes, juges, jurisconsultes »Barbara ANAGNOSTOU-CANAS. Éditions Panthéon-Assas, diffuseur LGDJ,, 333 p., 2006
Ouvrages
hal-00129033
v1
|
|
Les Méditations métaphysiques sur les vraies et fausses idées de la justiceIsabelle Brancourt et Laurent Fedi. Fayard, pp.798, 2005, Corpus des oeuvres philosophiques
Ouvrages
halshs-00554477
v1
|
|
Débats du Parlement pendant la minorité de Louis XIVLibrairie Honoré Champion, pp.653, 2002, Pages d'archives, Françoise Hildesheimer
Ouvrages
(édition critique)
halshs-00554478
v1
|
|
|
|
Le chancelier Henri François d'Aguesseau (1668-1751)Isabelle Storez. Editions Publisud, pp.635, 1996, La France au fil des siècles, Françoise Hildesheimer et Odile Krakovitch
Ouvrages
halshs-00551610
v1
|
Avant faire droit : la peste de 1720-1721, les faits dans les échos du tempsJoël Hautebert; Anne Dobigny-Reverso; Carole Auroy. La pandémie dans l'histoire. Regards croisés entre droit et littérature, PURennes, A paraître
Chapitre d'ouvrage
hal-03503340
v1
|
|
« Méconnu ? Henri François d’Aguesseau au risque du XXIe siècle »Isabelle Brancourt; Pascal Plas. Henri François d'Aguesseau. Magistrat, chancelier et législateur, Mare et Martin, pp.19-33, 2022, Grands personnages, 978-2-84934-594-8
Chapitre d'ouvrage
halshs-03760055
v1
|
|
|
|
À l’heure de l’alliance du Trône et de l’Autel : religion, droit et politique chez d’AguesseauIsabelle Brancourt; Pascal Plas. Henri François d’Aguesseau. Magistrat, chancelier, législateur, Mare & Martin, 2022, Grands personnages, 978-2-84934-594-8
Chapitre d'ouvrage
halshs-03096287
v1
|
|
|
De Pascal (après la Fronde) à d’Aguesseau (sous la Régence), séditions et révoltes comme mal « absolu ». Aux origines du conservatismeMerle (Alexandra); Mestre Zaragozá (Marina). Séditions et Révoltes dans la réflexion politique de l’Europe moderne, 32, Classiques Garnier, pp.277-295, 2022, Constitution de la modernité, 978-2-406-12791-8
Chapitre d'ouvrage
halshs-03715631
v1
|
|
|
Monarchie ou royauté ? Royauté ou monarchie ? Question de légitimité politique ou de légitimation du politiqueL'Institution monarchique. Passé, permanence et avenir, pp.223-260, 2021
Chapitre d'ouvrage
halshs-03196740
v1
|
The Parliament of Paris and the Making of the Law at the Beginning of the Eighteenth CenturyGuido Rossi. Authorities in Early Modern Law Courts, 16, Edinburgh University Press, pp.184-201, 2021, Edinburgh Studies in Law, 978-1-4744-5100-0
Chapitre d'ouvrage
halshs-03096280
v1
|
|
|
|
Sacre, légitimité et continuité monarchique : Jeanne d’Arc ou le « droit » à l’épreuve des faits‘France, mère des Arts, des Armes et des Lois’, Liber amicorum ou Mélanges en l’honneur de Jean-Gabriel Nancey, 2021
Chapitre d'ouvrage
halshs-03096278
v1
|
IntroductionIsabelle Brancourt. Au cœur de l’État. Parlement(s) et cours souveraines sous l’Ancien Régime, Classiques Garnier, p. 7-30, 2020, Constitution de la Modernité, 978-2-406-09783-9 et 978-2-406-09784-6
Chapitre d'ouvrage
halshs-04064050
v1
|
|
La messe rouge, entre Parlement et Sainte-Chapelle : un témoignage inédit sur la liturgie du début du XVIIIe siècleIsabelle Brancourt. Au coeur de l'Etat. Parlement(s) et cours souveraines sous l'Ancien Régime, 20, Classiques Garnier, pp.89-107, 2020, Constitution de la modernité, 978-2-406-09783-9
Chapitre d'ouvrage
halshs-01181417
v1
|
|
Henri François d’AguesseauOlivier Descamps; Rafael Domingo. Great Christian Jurists in French History, Cambridge University Press, p. 228-244, 2019, 978-1-108-48408-4
Chapitre d'ouvrage
halshs-04064029
v1
|
|
Histoire et temps présent des Persans à Paris : valeur historiographique des Lettres persanes de MontesquieuPhilippe Pichot-Bravard. Liber amicorum Jean de Viguerie, Via Romana, p. 159-194, 2017, 978-2-37271-076-3
Chapitre d'ouvrage
halshs-04064067
v1
|
|
Bruits et faux-bruits, médisances et calomnies, dans les couloirs du Palais (Paris. 1712-1744)Monique Cottret; Caroline Galland. Peurs, rumeurs et calomnies, Editions Kimé, p. 351-368, 2017, 978-2-84174-781-8
Chapitre d'ouvrage
hal-04065001
v1
|
|
Henri François d'Aguesseau (Limoges. 27 novembre 1668 - Paris. 9 février 1751)Le Livre des Commémorations nationales 2018, Editions du Patrimoine, pp.79-81, 2017, 978-2-7577-0572-8
Chapitre d'ouvrage
halshs-02913171
v1
|
|
De la biographie d’un chancelier à l’histoire d’un commis, plongée dans un océan archivistique et historiographiqueBertrand Augé. Essais en hommage à John Rogister : Regards nouveaux sur les institutions représentatives de l’ancien régime, la Cour, la diplomatie, la guerre et la littérature, A. Pedone, p. 63-84, 2017, 978-2-233-00847-3
Chapitre d'ouvrage
halshs-04064069
v1
|
|
La Famille, entre Parlement et le Roi : un pacte sacré (1700-1737)Pensée politique et famille, Actes du XXIVe colloque de l’AFHIP (mai 2015), PUAM, p. 159-165, 2016, 978-2-7314-1023-5
Chapitre d'ouvrage
halshs-04064072
v1
|
|
Du parquet à la chancellerie : D’Aguesseau et le contrôle des juges dans la première moitié du XVIIIème siècleFollain, Antoine. Contrôler et punir : les agents du pouvoir, XVe-XVIIIe siècles, Éd. universitaires de Dijon, pp.79-92, 2015, Histoires, 978-2-36441-121-0
Chapitre d'ouvrage
halshs-01177458
v1
|
|
Du parquet à la chancellerie : D’Aguesseau et le contrôle des juges dans la première moitié du XVIIIème siècleAntoine Follain. Contrôler et punir : les agents du pouvoir, XVe-XVIIIe siècles, Éditions universitaires de Dijon, p. 79-92, 2015, 978-2-36441-121-0
Chapitre d'ouvrage
halshs-04064074
v1
|
|
|
|
Entre Anciens et Modernes. Ou comment écrivent et pensent les jurisconsultes du début du XVIII e siècleChristelle Bahier-Porte; Claudine Poulouin. Ecrire et penser en Moderne (1687-1750), 187, Honoré Champion, pp.395-410, 2015, Les dix-huitièmes siècles, 978-2-7453-2958-5
Chapitre d'ouvrage
halshs-01248115
v1
|
|
|
LES "LOIS FONDAMENTALES DE L'ESTAT" DANS QUELQUES DÉLIBÉRATIONS CRUCIALES DU PARLEMENT DE PARISDamien Salles; Alexandre Deroche; Robert Carvais. Etudes offertes à Jean-Louis Harouel. Liber amicorum, Editions Panthéon-Assas, pp.131-145, 2015, 979-10-90429-59-8
Chapitre d'ouvrage
halshs-01235251
v1
|
Bruits de réforme dans Paris sous le ministère du Cardinal de Fleury ?Dufour, Alfred and Harouel, Jean-Louis and Montagut i Estragués, Tomàs de. La dynamique du changement politique et juridique : la réforme, 22, Presses universitaires d'Aix-Marseille, pp.143-152, 2013, Collection d'histoire des idées politiques, 978-2-7314-0882-9
Chapitre d'ouvrage
halshs-01177350
v1
|
|
Le chancelier d’Aguesseau et la République des LettresFrédéric Bidouze. Les Parlementaires, les Lettres et l’Histoire au siècle des Lumières. 1715-1789, Presses universitaires de Pau, p. 283-294, 2008, 2-35311-007-X
Chapitre d'ouvrage
hal-04065350
v1
|
|
Conclusion de la 2e partieLe Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècles), Librairie Honoré Champion - Slatkine, p. 721-731, 2007, 978-2-7453-1681-3
Chapitre d'ouvrage
hal-04065275
v1
|
|
Au pays des sources. Question de méthodeLe Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècles), Librairie Honoré Champion - Slatkine, p. 539-555, 2007, 978-2-7453-1681-3
Chapitre d'ouvrage
hal-04065218
v1
|
|
Vers la punition, histoire politique et judiciaire des translations sous la Fronde et au XVIIIe siècleLe Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe - XVIIIe siècle), Honoré Champion, pp.537-731, 2007
Chapitre d'ouvrage
hal-00273165
v1
|
|
De la routine… Pontoise en 1720, « ville parlementaire »Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècles), Librairie Honoré Champion - Slatkine, p. 647-682, 2007, 978-2-7453-1681-3
Chapitre d'ouvrage
hal-04065247
v1
|
|
Le dernier schisme parlementaire de l’Ancien Régime : Pontoise en 1652Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècles), Librairie Honoré Champion - Slatkine, p. 583-645, 2007, 978-2-7453-1681-3
Chapitre d'ouvrage
hal-04065235
v1
|
|
Montargis en 1649Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècles), Librairie Honoré Champion - Slatkine, p. 557-581, 2007, 978-2-7453-1681-3
Chapitre d'ouvrage
hal-04065227
v1
|
|
Essai de typologie. Translation : exil ou bannissement ?Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècles), Librairie Honoré Champion - Slatkine, p. 61-115, 2007, 978-2-7453-1681-3
Chapitre d'ouvrage
hal-04065203
v1
|
|
Complément de nom, complément de lieuLe Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècles), Librairie Honoré Champion - Slatkine, p. 43-60, 2007, 978-2-7453-1681-3
Chapitre d'ouvrage
hal-04065195
v1
|
|
« De la translation du Parlement »Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècles), Librairie Honoré Champion - Slatkine, p. 33-41, 2007, 978-2-7453-1681-3
Chapitre d'ouvrage
hal-04065182
v1
|
|
…à la grève : le « Tome Deux » de Pontoise et l’exil de Troyes (1753 et 1787)Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe-XVIIIe siècles), Librairie Honoré Champion - Slatkine, p. 683-720, 2007, 978-2-7453-1681-3
Chapitre d'ouvrage
hal-04065257
v1
|
|
Avant-propos et "De la translation du ParlementLe Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe - XVIIIe siècle), Honoré Champion, pp.7-115, 2007
Chapitre d'ouvrage
hal-00273438
v1
|
|
En marge de l’histoire du Parlement de Paris : les translations « pour procès » de Vendôme et de Noyon au XVe siècleBarbara Anagnostou-Canas. Dire le droit : normes, juges, jurisconsultes, Éditions Panthéon-Assas, LGDJ Diffuseur, p. 223-251, 2006, 978-2-913397-67-5
Chapitre d'ouvrage
hal-04065377
v1
|
|
De l'utilité de la réédition des manuscrits anciensBernard Barbiche et Yves-Marie Bercé. Etudes dur l'Ancienne France offertes en hommage à Michel Antoine, Ecole des chartes, p. 409 à 418, 2003
Chapitre d'ouvrage
halshs-00582628
v1
|
|
|
|
La Parole est au ParlementLibrairie Honoré Champion. Débats du Parlement de Paris pendant la Minorité de Louis XIV, Honoré Champion Editeur, pp.653, 2002, Pages d'archives
Chapitre d'ouvrage
halshs-00551668
v2
|
|
|
La "Bienfaisance" en France au siècle des Lumières. Histoire d'un motSociété et religion en France et aux Pays-Bas. XVe-XIXe siècle, 2000
Chapitre d'ouvrage
halshs-03195543
v1
|
|
|
Dans l'ombre de Messieurs les gens du Roi : le monde des substitutsJean-Marie Carbasse. Histoire du parquet, Presses Universitaires de France et GIP Justice, p. 157 à 204, 2000
Chapitre d'ouvrage
halshs-00582629
v1
|
La Bienfaisance en France au siècle des Lumières. Histoire d'une idéeGilles Deregnaucourt. Société et religion en France et aux Pays-Bas. XVe-XIXe siècles, Artois Presses Université, p. 525 à 537, 2000, Mélanges en l'honneur d'Alain Lottin
Chapitre d'ouvrage
halshs-00582630
v1
|
Des estats à l'Etat" : la pensée des juristes modernes face au pouvoir nobiliaire (1600-1750)Les juristes modernes et la noblesse, Dec 2006, Villeneuve d'Ascq, France. p. 49 à 65
Communication dans un congrès
halshs-00580430
v1
|
|
Des "estats" à l'Etat : la pensée des juristes modernes face au pouvoir nobiliaire (1600-1789)Des "estats" à l'Etat : la pensée des juristes modernes face au pouvoir nobiliaire (1600-1789), Dec 2006, Lille, France. pp.49-65
Communication dans un congrès
halshs-00425569
v1
|
|
Sic itur ad astra : quand le janséniste d'Aguesseau aborde le PolitiqueD'Aguesseau et la politique, Nov 2004, Paris, France. p. 79 à 90
Communication dans un congrès
halshs-00580423
v1
|
|
« Le chancelier d'Aguesseau et la République des Lettres »« Le chancelier d'Aguesseau et la République des Lettres », Jun 2006, Pau, France. p. 283-294
Communication dans un congrès
hal-00322051
v1
|
|
« En marge de l'histoire du Parlement de Paris : les translations « pour procès » de Vendôme et de Noyon », Actes du colloque des 3-4 novembre 2004 à ParisDire le droit : normes, juges, jurisconsultes, 2006, France. p. 223-251
Communication dans un congrès
hal-00141320
v1
|
|
|
|
En marge de l'histoire du Parlement de Paris2006, pp.223-251
Communication dans un congrès
halshs-00005039
v1
|
« L'intérêt - public et privé - dans la pensée de la magistrature louis-quatorzienne »Histoire de l'intérêt général, 2006, France. p. 195-209
Communication dans un congrès
hal-00141321
v1
|
|
« En marge de l'histoire du Parlement de Paris : les translations « pour procès » de Vendôme et de Noyon »Dire le droit : normes, juges, jurisconsultes, 2004, PARIS, France. pp.223-251
Communication dans un congrès
hal-00271215
v1
|
|
|
LE PARLEMENT DE PARIS AU RISQUE DES ARCHIVES Le Parquet, le greffe, la courHistoire. Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2005
HDR
tel-01006136
v1
|
|
|
LA « CONSTITUTION DE L’ÉTAT »… Ou la grande illusion de la magistrature parlementaire du XVIIIème siècle ?2020
Autre publication scientifique
halshs-03098702
v1
|
|
|
Le Parlement et la fabrique de la norme au XVIIIe siècle2000
Autre publication scientifique
halshs-00840250
v1
|
|
|
Port-Royal et l'Histoire1999, pp.149-152
Autre publication scientifique
halshs-00989198
v1
|


