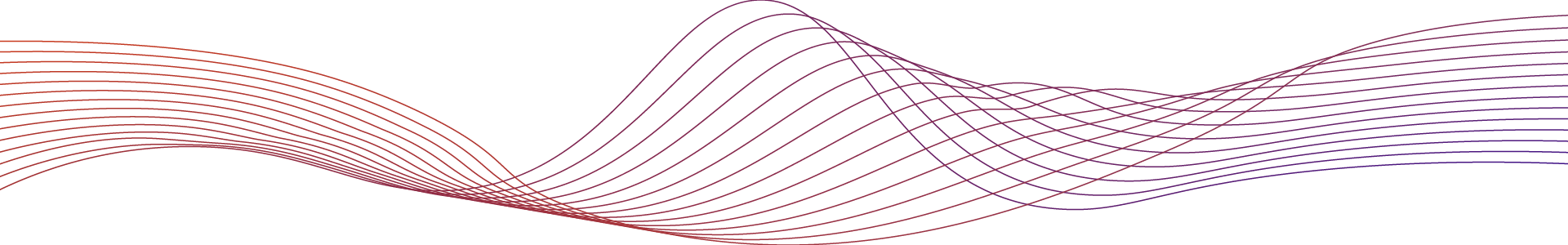
Juliette Banabera
- Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Faculté des Sciences humaines et des sciences de l'environnement (UPVM UM3 UFR3)
- Archéologie des Sociétés Méditerranéennes (ASM)
Présentation
Le travail entamé en Master a tout d'abord porté sur les représentations genrées et l'expression de l'individualité au sein du corpus des statues-menhirs du Rouergue et du Haut-Languedoc au Néolithique final, dans le sud de la France. Il se centrait sur un corpus réduit de statue-menhirs dont certaines échappaient à une catégorisation binaire féminin/masculin et sur la répartition dans l’espace des catégories masculines, féminines et transgenres. Cette étude succède à un mémoire de première année de Master se focalisant sur les discours identitaires genrés au sein de la littérature archéologique abordant ces statue-menhirs. Cette étude se focalisait notamment sur les interprétations générées autour des représentations attribuées au féminin et au masculin.
Mon travail de thèse porte, quant à lui, sur les représentations anthropomorphes sculpturales en Méditerranée nord-occidentale. Elles s'intéressent notamment à la variabilité chronologique et spatiale des expressions de genre du IVe millénaire au Ier millénaire avant notre ère. Le projet consiste en une recherche comparative des représentations anthropomorphes abordée par le prisme du genre en Méditerranée occidentale, englobant ainsi le sud et l’est de la Péninsule Ibérique, le sud de la France, l’Italie (dont l’arc alpin) et les îles méditerranéennes (Corse, Sardaigne, Sicile et Chypre), dans une période délimitée entre le IVe millénaire avant notre ère et l’âge du Bronze final. A partir de ces représentations, l’objectif est d’observer les traitements du genre dans le temps et dans l’espace pour tenter d’en comprendre les dynamiques culturelles. Questionner les dynamiques culturelles met en lumière plusieurs axes de recherche, dont l’étude des contacts entre les populations de la Méditerranée nord-occidentale, que cela soit au niveau des échanges culturels, de l’économie ou de l’expression du genre. En outre, une des problématiques est l'analyse de la représentation et la perception des individu·e·s genré·e·s au sein des communautés dans des contextes divers et des temporalités, notamment à la jonction entre la fin du Néolithique et le début de l’âge du Bronze. En effet, la mise en contexte de ces représentations permet également la caractérisation des communautés et participe à la définition de leurs limites culturelles (Lopez-Molvato, 2011).
Publications
Publications
Into the wild. Repenser les rencontres protohistoriques entre les sociétés humaines et leur environnement. XIe Rencontres doctorales de l'école européenne de Protohistoire de Bibracte, Bibracte, 12-16 mars 2025XIe Rencontres doctorales de l'école européenne de Protohistoire de Bibracte, Mar 2025, Glux en Glenne (Bibracte), France. 2026
Proceedings/Recueil des communications
hal-05035226
v1
|
|
|
Statues-menhirs du Rouergue et du Haut-Languedoc : symboles, discours « identitaires » genrés et pouvoir au Néolithique finalHiatus, lacunes et absences : identifier et interpréter les vides archéologiques, Actes du 29e Congrès préhistorique de France, 31 mai-4 juin 2021, Toulouse, Session Où sont les femmes ? Archéologie du genre dans la Préhistoire et la Protohistoire : la France à l’écart des gender studies ?, Société préhistorique française, pp.137-152, 2024
Chapitre d'ouvrage
hal-04648783
v1
|
