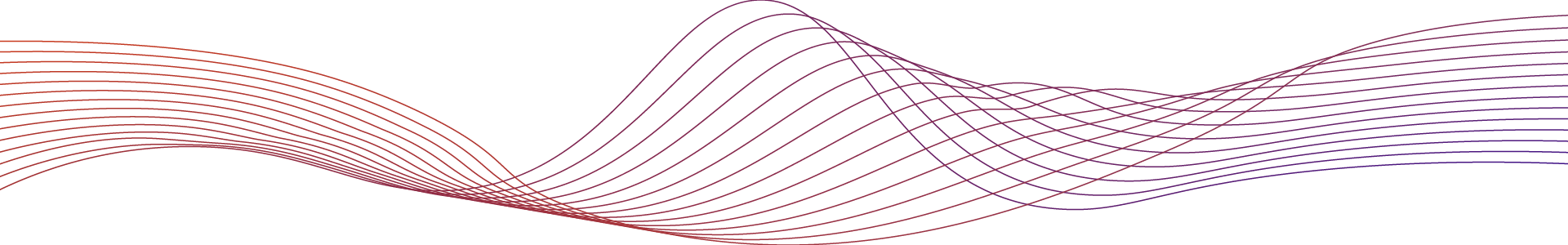
Ludovic GARATTINI
- Centre d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires de l'UFR LAC (CERILAC (URP_4410))
- Histoire des technosciences en société (HT2S)
Présentation
Docteur en Sciences de l’information et de la communication de l’Université de Paris (actuellement Paris Cité) et anciennement ATER de l’équipe HT2S, Ludovic Garattini est à présent responsable des programmes de la fondation écologiste « Green Forum » à Stockholm pour le continent africain, perimétre qu’il vient d’étendre aux Balkans et à l’Europe de l’Est. Il est également Chercheur Associé au laboratoire HT2S du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).
Ses projets scientifiques portent sur les dispositifs et milieux à travers lesquels les enjeux climatiques interagissent avec les problématiques techniques et politiques impliquées dans les processus de confrontation, de décision et d’implémentation des programmes sociaux, économiques et environnementaux. Ses précédents travaux sur le mode d’être communicationnel des objets techniques lui ont permit d’expérimenter (France, Suisse, Suède Japon) l’approche épistémologique et taxinomique développée par Gilbert Simondon, une approche qui avait fait jusque là l’objet de débats théoriques relativement peu ancrés et partiels. Ces expérimentations lui ont permis de développer le concept de « dispositifs techniques inchoatifs », dispositifs analysés et situés comme « êtres communicationnels » à travers des modèles heuristiques qui diffèrent en fonction des échelles d’organisation à partir desquelles on les considère (élémentaire, individuelle, d’ensemble ou de réseau technique).
Ses travaux actuels portent ainsi sur l’inchoativité des dispositifs techniques approchés comme êtres communicationnels faisant participer leur réalité technique interne à la réalité des milieux sociotechniques dans lesquels ils fonctionnent, les analysant à l’aide de cette modélisation scalaire issue de sa thèse de doctorat. Cette orientation différe de l’approche comportementaliste que l’on peut trouver en sociologie des sciences et techniques en ce qu’elle ne considère généralement pas le dispositif technique seulement comme acteur vectorialisé d’un champ d’interactions externes, normatif et lui préexistant (c’est-à-dire depuis sa valeur d’usage et ses effets), mais aussi depuis la réalité technique de ses multiples opérations, fonctionnements, organisations et mode d’interactions externes et internes à différentes échelles d’organisation. Ces expérimentations de déconstruction de la valeur d’usage dans la prise en compte des dispositifs techniques s’accompagnent d’une complexification du dispositif mais permettent en retour de les sortir d’un non-lieu épistémique, en utilisant les mêmes cadres physicochimiques et communicationnels que ceux utilisés pour décrire leurs milieux de fonctionnement. Cette complexification possède l’avantage de positionner correctement les usages et l’agentivité des dispositifs techniques fonction de leur réalité technique, aux échelles où ils interagissent effectivement avec leurs milieux. Cette opération se résume ce faisant à mettre en cohérence deux réalités ontogénétiques a priori disparates (individu technique/milieu de fonctionnement).
L’hypothèse de travail du chercheur repose sur le sentiment qu’il serait ce faisant possible de transformer et de mettre à l’échelle une compréhension correcte et fonctionnelle des milieux de fonctionnement et des dispositifs techniques pour y inclure la dimension écosystémique, elle aussi scalaire (élément, individu, ensemble et réseau). Cette dernière comprendrait les régimes d’individuation des systèmes du biotope dans lequel les dispositifs techniques fonctionnent effectivement en opérant les médiations entre humains et milieux naturels : leurs technotopes. La recherche ambitionne ainsi de participer aux travaux d’autres collègues sur les ajustements à apporter aux réalités politiques, historiques, économiques, scientifiques et techniques qui grèvent les débats de société autour des enjeux climatiques (matière, énergie, justice, agriculture, modèle de transition, développement durable, techno-démocraties, écologie décoloniale et justice sociale), en redéfinissant et en repositionnant à l’échelle l’agentivité centrale et infrangible des systèmes techniques impliqués par (ou responsable de) ces enjeux.
Domaines de recherche
Compétences
Publications
Publications
|
|
What Has Europe Ever Done To/For Us: Europe's Gordian Knot in Drifting Climate and Geopolitics2025, pp.95. ⟨10.5281/zenodo.15665640⟩
Autre publication scientifique
hal-05113369
v1
|
|
|
EN-QUÊTE D’EXISTENCE. LE NON-ÊTRE DES MACHINES (Épisode 1 : Antiquité) Machines, Climat et Démocratie2023
N°spécial de revue/special issue
hal-03929757
v1
|
|
|
L'être communicationnel des machines : le cas du robot humanoïde en France et au JaponSciences de l'information et de la communication. Université Paris Cité, 2021. Français. ⟨NNT : 2021UNIP7107⟩
Thèse
tel-03857752
v1
|
|
|
Berenson, « l’anti robot-travail » (Entretien)Tracés : Revue de Sciences Humaines, 2017, 32, pp.237--258. ⟨10.4000/traces.6930⟩
Article dans une revue
halshs-01843630
v1
|
|
|
Sylvie Catellin, Sérendipité. Du conte au conceptLectures, 2014, ⟨10.4000/lectures.15191⟩
Article dans une revue
(compte-rendu de lecture)
halshs-04732398
v1
|

